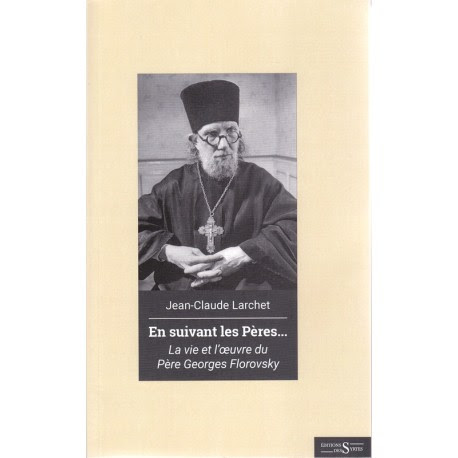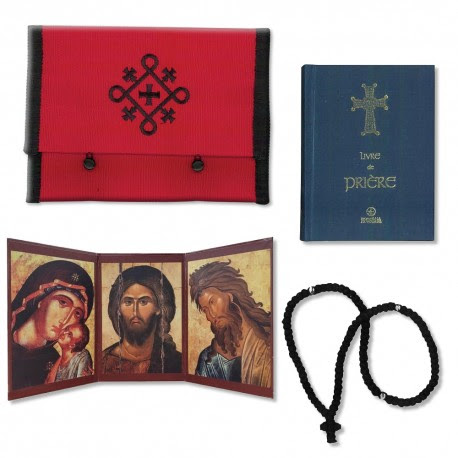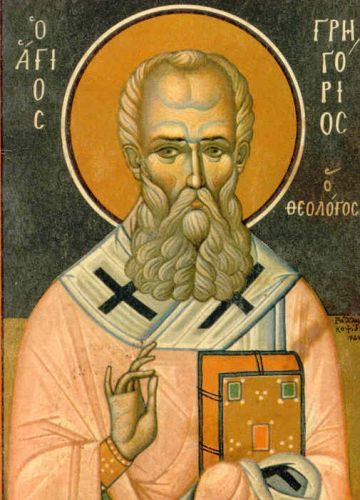Tout va changer. Vous voyez, le problème n'est pas la foule et le rassemblement. Cela n'a jamais été le cas.
Le problème, c'est la Sainte Communion. Pour l'État, tout ce que nous disons en tant que chrétiens n'est pas convaincant. Deux mille ans d'histoire, c'est une lettre morte.
Pour l'État, la Sainte Communion, telle qu'elle est transmise aux fidèles, est un moyen de transmettre des maladies.
L'État n'est pas religieux. Lorsque vous voyez les dirigeants les plus éminents s'entasser devant la solea d'une église à l'approche d'une élection, demandez-leur.
Ne perdez donc pas votre temps à faire deux poids, deux mesures. Ne comparez pas une église orthodoxe à un super marché, à des banques, des grands magasins et des cafés. C'est pire.
Le débat s'est déjà ouvert - publiquement par les lèvres de la hiérarchie officielle - sur la modification de la façon dont nous recevons la Sainte Communion, sur la base de l'ancienne tradition de la Divine Liturgie de Saint Jacques.
C'est-à-dire en prenant d'abord le Corps dans la main droite et en buvant ensuite le Sang dans une tasse commune.
Même cela pourrait les déranger, cela ne leur conviendrait pas, et finalement nous recevrons des portions individuelles préparées de pain trempées dans du vin.
Vous savez quoi ? Cela ne me dérange pas.
Lorsque les martyrs étaient en prison, les chrétiens leur apportaient la Perle Divine cachée dans des fruits, comme une pomme ou un raisin, comme on le faisait pour sainte Argyrie [#]. Il y a beaucoup d'exemples de ce genre dans la vie des saints martyrs.
Il existe une histoire étonnante sur la Divine Liturgie pendant les années du régime soviétique athée. Pardonnez-moi de ne pas me rappeler exactement où j'ai lu cette histoire.
Dans une ville russe, les bolcheviks, voulant ridiculiser le culte des orthodoxes, se sont mis d'accord et se sont rendus à l'église principale.
Parmi eux, il y avait un membre du parti, diplômé d'une école de séminaire. Il savait lire les prières dans les livres liturgiques.
Ils sonnèrent donc la cloche et firent des annonces pour que les personnes qui voulaient participer à la Liturgie arrivent, et ledit bolchevique se mit à revêtir des vêtements sacerdotaux pour accomplir la Divine Liturgie.
Il fit tout. Il lut l'Évangile et consacra également les Saints Dons. Au lieu de vin, il mit de la vodka et ajouta un morceau de pain sec.
Au moment de la Divine Communion, il les a tous communiés avec le plus grand sérieux.
Quand tout fut terminé, les rires et les divertissements des athées commencèrent. Il jeta le Saint Calice et cria aux chrétiens surpris qu'on les avait trompés et qu'on leur avait donnés de la vodka et du pain.
Ils se mirent à les battre, à rire d'eux, à les maudire vulgairement. Sans être dérangé, un vieil homme s'approcha de la vodka renversée sur le sol avec les restes du pain.
Et il commença à lécher le sol pour qu'il ne reste rien, comme le faisait le prêtre pour la Sainte Communion. Tout le monde était stupéfait. "Que fait le vieil homme ? Est-il complètement fou ?" Ils le laissèrent finir.
Il se releva et leur dit…
"Mes enfants, je suis prêtre. Tout au long de votre acte comique, j'ai regardé le Très-Saint Esprit agir. Nous avons tous communié au Corps et au Sang du Christ. Que Dieu vous pardonne pour ce que vous avez fait. Mais merci d'être la cause d'un tel don dans une période aussi sombre."
L'histoire, dont l'analyse essentielle n'est pas contenue à l'intérieur, se poursuit avec une fin martyre pour beaucoup de ceux qui étaient présents.
Où est-ce que je veux en finir ? Dieu regarde le choix. Si notre foi est solide et certaine, elle ne sera ébranlée par rien.
Si elle est tiède, elle s'égarera. Hélas.
Si je crois au miracle des miracles mais que j'ai peur de ce qui se trouve devant moi, alors tout est vain. La motivation et le choix de chacun les jugeront le moment venu.
°°°
[*]Sainte Argyrie
[...]
Issue d’une pieuse famille grecque de Prousse (Bithynie), sainte Argyrie venait de contracter mariage, lorsqu’un Turc de ses voisins tomba follement amoureux de la jeune épousée. Ayant été repoussé dans ses propositions, il la dénonça auprès du juge local, prétendant qu’elle s’était engagée à se convertir à l’Islam.
Elle fut arrêtée et transférée à Constantinople pour y être jugée. Devant son accusateur, elle répétait avec calme et résolution, malgré les coups et les tortures répétés, qu’elle n’avait jamais fait de telles promesses et qu’elle était prête à mourir chrétienne.
Les audiences et les emprisonnements successifs durèrent pendant dix-sept années complètes sans que la sainte ne cédât aux pressions des juges ou des femmes de mauvaises vies qui partageaient sa cellule et ne cessaient de la tourmenter.
Elle ajoutait à ces épreuves les labeurs du jeûne et de la prière, et était remplie d’une telle joie de souffrir ainsi par amour du Christ que, lorsqu’un riche chrétien intervint pour la faire libérer, elle refusa de quitter sa prison qu’elle considérait comme un palais royal. Elle trépassa ainsi dans son cachot et fut ensevelie par des chrétiens. Trois ans plus tard, on découvrit son corps incorrompu et dégageant un délicieux parfum.
La mémoire de la sainte nouvelle martyre Argyrie le 30 avril. (source)