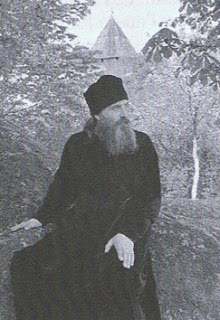Notre famille n’ayant jamais eu de voiture, lorsque je traversais les vastes
espaces de la région de Pskov dans la Zaporojets noire du père Rafaïl, je
croyais son style de conduite tout à fait banal. Je ne devinai que bien plus
tard que ce n’était pas absolument exact. Le père Rafaïl était un excellent
conducteur : à Tchistopol, il n’avait pas fait que des courses à vélo, il avait
aussi participé à des rallyes automobiles au niveau régional.
Il ne freinait que pour s’arrêter. Dans tous les autres cas, il fonçait. Il
préférait ne pas utiliser les freins afin, comme il le disait, de ne pas user leurs
sabots. Il pouvait aussi, tout en roulant, se mettre tout à coup à arranger
le volant, l’enlever et fourrager dans la colonne de direction. Et, juste au
dernier moment, remettre le volant en place et prendre un tournant. J’étais
habitué à ce type de conduite, mais certains passagers s’en effrayaient au
point d’en perdre l’usage de la parole.
Un jour où nous roulions vers Pskov, nous aperçûmes au bord de la
route, à une bonne soixantaine de kilomètres de la ville, un prêtre faisant
du stop. Nous le connaissions bien : c’était le père Gueorgui, un peintre
de Saint-Pétersbourg qui avait choisi la prêtrise et était venu officier dans
une paroisse de l’éparchie de Pskov.
Je m’assis à l’arrière, et lui, à côté du
chauffeur, et nous redémarrâmes.
Le père Gueorgui s’accrocha aussitôt aux accoudoirs et, tout tendu,
regarda droit devant lui. Comprenant que notre coéquipier n’avait guère
envie de soutenir la conversation, nous parlâmes de nos problèmes. Au
bout de quelque temps, le père Rafaïl marmonna que la voiture se déportait
et que le volant faisait encore des siennes. Sur un tronçon de ligne droite,
il l’ôta, comme à l’accoutumée, sans ralentir, et se pencha vers la colonne
de direction tout en surveillant d’un oeil la route. Et tout en maudissant,
par habitude, le pouvoir soviétique incapable de fabriquer des automobiles
correctes.
Un tournant se profilait et j’en prévins le père. Il regarda la route,
corrigea encore quelque chose dans la direction et tenta enfin de remettre
le volant en place. Mais celui-ci ne voulait pas.
– Père, ça approche, fis-je remarquer, signifiant par là que l’on ne
pourrait tourner sans volant.
Le père Rafaïl se dépêcha, mais sans décélérer. Il parvint à la dernière
minute à remettre le volant, braqua brusquement et nous fit traverser sans
encombres la zone dangereuse. Encore quelques critiques à notre industrie
automobile, puis nous passâmes à un sujet tout aussi captivant. Nous
avions déjà oublié l’incident quand du siège avant s’éleva le cri inhumain
du père Gueorgui :
– Arrête !!! Arrête !!!
Le père Rafaïl en fut si épouvanté qu’il passa outre tous ses principes et
appuya sur les freins.
– Que vous arrive-t-il, père ?! demandâmes-nous d’une seule voix.
En guise de réponse, le père Gueorgui bondit hors de la voiture. Une
fois sur la chaussée, il passa la tête par la portière et s’écria :
– Plus jamais ! Tu entends ? Plus jamais je ne monterai dans ta voiture !
Nous comprîmes alors que les manipulations du volant l’avaient mis
au bord de la syncope. Nous lui demandâmes pardon, promîmes de
rouler désormais doucement et en faisant bien attention, mais il refusa
catégoriquement de revenir à bord de la Zaporojets noire. Il s’éloigna et se
remit à faire du stop, nous incendiant de temps à autre du regard.
*
Malgré le côté, avouons-le, voyou du père Rafaïl, tous remarquaient
non seulement l’efficacité de ses prières, mais la force de sa bénédiction
sacerdotale.
Un jour, nous nous disputâmes. Je ne me souviens plus à
quel sujet, mais je lui fis la tête. C’était la fête patronale de la Dormition,
à Petchory, mais j’étais si fâché que je décidai de rentrer à Moscou sans
attendre l’office de l’Ensevelissement de l’epitaphios de la Très Sainte
Vierge qui se déroule au monastère le surlendemain de la Dormition.
Juste avant de partir, tout en m’efforçant de marquer mon indifférence
et mon indépendance, je m’approchai du père Rafaïl afin de recevoir sa
bénédiction pour mon voyage.
– Comment osez-vous quitter l’enterrement de la Mère de Dieu,
Gueorgui Alexandrovitch ? me demanda-t-il stupéfait. Je ne vous
donnerai ma bénédiction pour rien au monde ! Restez prier ce soir lors de
l’Ensevelissement et vous repartirez après.
– Ah c’est comme ça ?! m’indignai-je. Eh bien, faites comme vous
voulez ! D’ailleurs la fête principale, celle de la Dormition, a déjà eu lieu.
N’importe quel autre père du monastère me donnera sa bénédiction.
Je lui tournai le dos et m’éloignai. Malheureusement, je ne rencontrai
aucun prêtre. Tous se préparaient au long office du soir ou s’adonnaient à
leurs travaux monastiques. Il restait peu de temps avant le départ du train
et je me pressai d’aller prendre le car. À la gare routière m’attendait une
autre tentation : il n’y avait pas de billets pour Pskov. Mais cela ne m’arrêta
pas. J’insistai auprès de la caissière et elle finit par me trouver un billet
pour un car incommode qui me permettait bien d’avoir mon train, mais
n’atteignait Pskov qu’après un long détour par les villages environnants.
maisons de bois trempées de pluie et les tristes champs labourés du Nord.
J’étais on ne peut plus déprimé. J’avais le coeur lourd à cause de cette
dispute avec le père Rafaïl que j’aimais pourtant beaucoup. Sans compter
mes remords d’avoir abandonné la cérémonie de l’Ensevelissement
de l’epitaphios et d’être parti sans avoir reçu de bénédiction pour mon
voyage…
« Où en suis-je arrivé ! », telle fut la phrase qui me traversa l’esprit
dans ce car antédiluvien qui lambinait avec force cahots.
Après avoir desservi les bourgs des environs, nous roulâmes enfin plus
vivement sur la route de Pskov. Par la fenêtre, j’aperçus une petite Jigouli
rouge qui tentait de nous dépasser. Je la suivis d’un regard distrait et la vis
foncer, mais nous ayant doublés, elle effectua un brusque virage à droite et
se retrouva sous les roues de notre Ikarous. On entendit un bruit grinçant
de ferraille et le hurlement des freins. Les voyageurs furent projetés vers
l’avant. Tous poussèrent des cris… Et moi, plus fort que tout le monde, car
je soupçonnai aussitôt que c’était à cause de moi !
Cela peut paraître bête et ridicule, mais quand j’évoque cette histoire,
survenue il y a longtemps, je suis encore persuadé que ce qui se passa fut
dû à mes péchés, à mon entêtement et à ma désobéissance. Mais dans la
panique générale, personne ne prêta alors la moindre attention à mes cris.
Le car entraîna la voiture sur plusieurs mètres encore, puis s’arrêta.
Notre chauffeur ouvrit la porte et se rua vers l’auto que son véhicule avait
heurtée. Le car surplombait littéralement la petite Jigouli. Les passagers se
précipitèrent à leur tour et restèrent pétrifiés devant l’auto toute cabossée.
Soudain, sa portière s’ouvrit en grinçant et un énorme terre-neuve noir en
bondit. Le chien se mit à geindre de façon déchirante et prit la fuite sur la
chaussée. Je n’avais jamais vu de chien, même épouvanté, replier à ce point
la queue jusqu’à la gorge. Une petite fille d’une douzaine d’années sortit
aussi de la voiture. Grâce à Dieu, elle était indemne !
« Prince ! Prince !
Reviens ! » cria-t-elle à l’adresse de l’animal, s’élançant à sa poursuite.
Notre chauffeur aida le conducteur à s’extirper de sa voiture. Il n’y avait
personne d’autre à bord. Apparemment, il n’avait pas de lésions graves,
mais l’accident l’avait fortement secoué et son visage était marqué de bleus.
La petite Jigouli du pauvre homme était hors d’usage.
Les voyageurs du car, voyant tout le monde sain et sauf, échangèrent
des propos avec soulagement. Je ressentis soudain une fureur encore plus
grande contre mon sort. Avec une dizaine de passagers, je me mis à faire du
stop dans l’espoir de parvenir à Pskov. Je m’enferrai dans mon obstination :
il en serait, de toute façon, comme j’en avais décidé ! Je partirais pour
Moscou coûte que coûte !
Je levai le pouce et sautillai sur le macadam pendant un quart d’heure,
mais personne ne s’arrêtait, car nous étions trop nombreux autour du car à
vouloir aller à Pskov.
Finalement, je compris en regardant ma montre que
je raterais mon train, quelles que soient les circonstances.
Au bout de quelques minutes, un car de ligne en provenance de Pskov
s’arrêta et son chauffeur proposa d’emmener ceux qui le souhaitaient à
Petchory.
Je n’avais pas le choix et je fus bientôt ramené à l’endroit que
j’avais fui de façon si honteuse.
L’office de l’Ensevelissement de l’epitaphios de la Mère de Dieu avait
débuté. Selon la tradition, il se déroulait à l’air libre, sur la place près de la
cathédrale de saint Mikhaïl. Je cherchai le père Rafaïl. Il ne fut absolument
pas étonné de me revoir.
– Ah ! Gueorgui Alexandrovitch, c’est vous !
– Pardonnez-moi, père, lui dis-je.
–
Après l’office, nous irons faire une petite visite à l’Ancien ?
J’acquiesçai, me mis à ses côtés, et nous ne nous laissâmes plus distraire
de la prière.
[...]
EDITIONS DES SYRTES
14 Place de la Fusterie